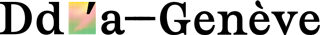Les futuristes louaient le bruit des moteurs. Marinetti, qui posait volontiers au volant de voitures de sport, assimilait dans son manifeste de 1909 le progrès des arts à la sensation roborative de la course folle d’une automobile se terminant, après une ultime embardée, au fond d’un fossé plein d’une saine « boue des usines ». La foi artistique de Delphine Reist et Laurent Faulon dans le progrès industriel est en revanche peu avérée. Les artistes semblent plutôt collecter des symptômes d’une civilisation productive malade de ses promesses, dont ils traversent les lieux désaffectés, composant avec les signes matériels d’une histoire mise entre parenthèses et inhabitée, mais où les choses vibrent malgré tout, comme attendant leur réaffectation, dans le double sens d’une refonctionnalisation et d’un réinvestissement subjectif.
Voilà pourquoi, dans les travaux de Reist et Faulon, le médium est machine. Il ne fait forme, en effet, que sous certaines conditions de fonctionnement. Qui plus est, ce fonctionnement est matériel, non pas seulement symbolique. Autrement dit, il ne leur suffit pas, pour faire œuvre, d’inscrire pragmatiquement l’objet dans un contexte symbolique où les signes s’interprètent comme art, à savoir dans le cadre du monde de l’art, des galeries ou des musées. Pendant des années, ces lieux ont été systématiquement évités par les deux artistes. Terrain vague, parking, usine abandonnée… c’est dans ces non-lieux que l’œuvre doit fonctionner, de façon autonome, pour autant que la mécanique des choses opère de façon particulière. Régler la mécanique des choses selon des paramètres matériels et spatiaux qui obligent à réaffecter les lieux de l’économie ordinaire de la vie sociale, en en faisant sentir la vacuité même, tel pourrait être le programme implicite des pièces de Reist et Faulon. Or, le moteur joue dans ce réglage un rôle autant d’instrument que de motif.
L’Europe entière n’est pas Detroit, Motor city en friche, mais son territoire est marquée depuis des décennies par les fermetures d’usines, le sous-emploi industriel et la production d’espaces désaffectés, abandonnés au rythme de l’arrêt des machines. À de nombreuses reprises depuis 2001 et leur premier projet commun d’occupation de lieux abandonnés (Occupation évolutive de Tercenas do Marquês , Lisbonne, 2001), Reist et Faulon sont venus au contraire activer ces espaces en friche. Comme dans Usine Occupée (2000), où Laurent Faulon investit pendant deux semaines un complexe industriel abandonné à Fribourg, ou Hüller Hille (2009), de Delphine Reist, qui fait marcher sans présence humaine des éléments des chaînes de production et de lavage de la cuisine d’une usine de pièces détachées automobile victime de la délocalisation : sorte de robot zombie s’agitant entre la vie et la mort, concert d’instruments mécaniques orchestrés par des âmes ouvrières fantomatiques, ruine motorisée.
Un moteur suppose un régime (que l’on mesure habituellement en tours/minutes) et un couple. Le couple moteur désigne en mécanique la force motrice développée par la combinaison d’une poussée exercée le long d’un axe, et d’un bras de levier, comme lorsque le pied du cycliste appuie sur la pédale pour faire tourner le plateau cranté (qui transmet ensuite son mouvement à la roue par l’intermédiaire de la chaîne). Si le moteur peut réunir le couple Reist et Faulon, les artistes agissent de même selon deux axes de force différents. Autant Laurent Faulon s’intéresse-t-il à la force mécanique sans transmission, comme dans les vélos d’appartement figés dans le silicone de Weiss Fitness Zentrum (2013), et qui produisent le sentiment d’une force impuissante, autant Delphine Reist cultive-t-elle la transmission de légers mouvements, la provocation de déplacements suspects qui donnent vie à des objets inanimés, à l’intérieur desquels l’artifice pourrait un instant faire oublier la mécanique. La cohérence de leurs pièces tient donc dans leur art des découplages moteurs. Il manque toujours au moins un élément mécanique pour que tout marche normalement. Une cause efficiente, humaine ou non, un résultat effectif, mesurable dans la ligne des moyens engagés… alors opère l’effet de levier esthétique, l’ouverture d’un espace d’expérience qui redonne sa place à une subjectivité située.
Qu’est-ce qu’un objet technique, un outil, ou un espace fonctionnel et productif, lorsque ses agents l’ont délaissé, lorsque les sujets qui en usaient et qui l’activaient se sont absentés ? Une empreinte. L’anthropologue Alfred Gell envisage les œuvres d’art comme des systèmes d’action dont les objets sont les indices1 . Ils renvoient à une « agentivité » (agency) c’est-à-dire à l’intention d’agents qui les activent. Ainsi, lorsqu’un musée expose, par exemple, des objets issus d’un rite funéraire traditionnel, il entre en conflit avec l’agentivité rituelle en désactivant l’objet pour en prendre possession formellement. De même, les pièces de Delphine Reist jouent souvent sur des objets posant un problème d’agentivité ou, en d’autres termes, de « moteur intentionnel ». Mais il ne s’agit pas pour l’artiste de prélever des objets extraits du contexte originel de leur fonctionnement, ici technique et non rituel, pour les esthétiser dans un cadre artistique. Loin de ce sens d’esthétisation, l’enjeu du travail de Reist tient au contraire dans une inscription de l’expérience au plus près des contextes pratiques originels de l’objet, où elle peut les faire fonctionner de manière à éprouver des dimensions non aperçues ou perdue de leur agentivité première. Quel moteur intentionnel opère-t-il dans la mécanique sociale et spatiale des choses ? Où se tient l’agent des opérations, et au-delà de lui peut-être, le sujet dont il reste une empreinte réduite à la forme d’une intention sans contenu ?
La question se pose face, par exemple, à ses Caddies (2003) qui se meuvent seuls en tournant en rond. Ou devant son Baril (2004), qui roule et se cogne contre les murs. Ou encore dans Parking (2003), lorsque des voitures en stationnement, chacune selon un rythme propre, démarrent automatiquement, sans personne au volant, avant que leur moteur ne se coupe dans l’attente d’une nouvelle amorce de mouvement, et d’un nouvel écho d’une intention motrice. Lors de Manœuvres 1/3, première étape d’une réponse collective en trois temps à une commande publique passée à Delphine Reist, l’artiste présente Parade (2008), où un demi-cercle de paires de bottes en caoutchouc frappent ensemble dans une flaque d’eau, dans le chantier du collège Sismondi à Genève. Dans Body Building, des sacs de sport d’un vestiaire sont mus par des mouvements fantômes. Dans toutes ses pièces Delphine Reist recourt à une motorisation productrice d’un mouvement artificiel, opérant un jeu entre force motrice et puissance. Parallèlement à l’idée d’empreinte intentionnelle, d’agentivité vide, on pourrait voir apparaître une dimension métaphysique de la puissance, au sens où les agents, les usagers, les sujets, les corps qui habituellement habitent, pratiquent ou manipulent les lieux et les choses devenues automates, sont ici mis en puissance. Ils n’existent pas en acte, ils n’agissent pas, ils n’exercent aucune force, mais le mouvement des choses n’est pas pensable sans la présence virtuelle des êtres qui apparaissent ici en négatif. Cette fois ce sont les choses qui désirent les êtres, ce sont les objets qui désirent les sujets. On voit que la question de Transmissions, titre du deuxième volet de Manœuvres sur le chantier du collège Sismondi, n’est pas qu’une question mécanique. Il s’agit de transferts de forces qui relèvent du désir et du savoir. La chose motorisée, tient lieu dans les œuvres de Reist de levier de transmission entre le corps et l’espace. Pas n’importe quel corps, pas n’importe quel espace : le banal, l’absent. Le mis au ban, l’abandonné, dans des conditions historiques extrêmement situées où, comme le dit Faulon, sans valeur ni héros l’art n’en a pas moins à être « valeureux ».
Loin d’une chevauchée mécanique épique, si un passager monté à bord du véhicule de Laurent Faulon devait consigner des notes en vue d’un hypothétique manifeste post ou plutôt no-futuriste, il rapporterait que l’artiste au volant utilise aussi peu la première que la dernière vitesse. Semblant parfois démarrer en seconde, ce n’est qu’à la faveur d’une forte augmentation du volume sonore dans l’habitacle qu’il choisit de passer en cinquième une fois lancé sur l’autoroute. L’anecdote invite à pointer dans son travail également l’enjeu d’un rapport entre puissance motrice et mouvement effectif. Chez lui, en l’occurrence, l’efficacité de la propulsion compte moins que la dépense d’énergie qui rend sensible la possibilité du mouvement.
Dans l’œuvre de Laurent Faulon, l’automobile, la moto ou la machine industrielle apparaissent omniprésents. O poço da morte (2003) tire son titre d’un spectacle de foire à Lisbonne où des motos tournent à l’intérieur d’un cylindre, suivant de périlleuses rotations à 360°. Dans son installation, le déplacement spectaculaire laisse place au point mort : un moteur automobile, doté d’un système d’échappement et dûment alimenté par des réservoirs et des tubes, comme un cœur artificiel ou un corps sous perfusion, est posé dans une pièce capitonné de moquette. Une pédale d’accélérateur est à la disposition du public, permettant à chacun de faire rugir cette puissance sans capacité motrice, tournée vers son mouvement propre, motorisation intériorisée qui démonte tout autant le spectacle du mouvement que la stance contemplative de la sculpture immobile. Le moteur, moyen matériel d’une autonomie impure de la forme artistique, peut aussi produire des images. C’est le cas dans Mes étoiles (2001-2012), où le véhicule de l’artiste produit l’énergie nécessaire à l’éclairage d’un vaste réseau de guirlandes posées au sol, dans une dérisoire astronomie de parking.
Autre forme d’autonomie paradoxale : dans Auréole (2008), une machine à nettoyer les sols, retenue par un câble, tourne en rond à l’intérieur d’une chapelle en laissant une traînée de cognac : circularité qui mêle le sacré et le profane, confond les esprits, macule la marque du saint. Autre chapelle : une salle est occupé par des réfrigérateurs couchés au sol et alignés comme des cercueils. Cette Chapelle ardente (2003) fait entendre comme une litanie, une prière marmonnée à plusieurs, à la faveur de la programmation d’une minuterie qui déclenche le son amplifié des moteurs électriques des systèmes de réfrigération. Cynique, l’installation détourne les transactions symboliques qui opèrent entre les choses matérielles et les significations qui sont censées les transcender. Là tout se joue à l’horizontal, dans l’immanence, et le moteur, sa manière de se mouvoir pour lui même avant toute projection, cette sorte de cœur mécanique est soumis lui aussi, comme les corps et les espaces physiques et sociaux avec lesquels il entre en rapport, à une forme de précarité. Un point de tension est en jeu ici, un point toujours situé à poço da morte, sur un axe existentiel coordonné par les paramètres matériels d’une civilisation industrielle déclinante. Déclinante du moins en ce qui concerne la valeur de la production physique. Car demeure au centre du système économique la valeur de la consommation, sous ses aspects symboliques et idéologiques d’image et de catalyseur libidinal.
Anti-spectaculaire, le travail de Faulon renvoie les choses à leur matérialité et, posant un problème d’usage ou détournant un fonctionnement, restitue comme désaffecté, mélancoliquement, le désir qui nous pousse vers ces choses. Ainsi, dans Désirons sans fin(2008), des objets sont recouverts de vaseline, inutilisables, figés, rendus à une certaine incapacité de mouvement, frustrant notre désir de les posséder ou seulement de les saisir. Parmi eux, une moto. Situation que l’on retrouve dans Heavy Rider (2010), où sept motos sont alignées, enduites de graisse industrielle. Ici la matière supposée fluidifier le mouvement mécanique vient embaumer les machines en les saturant de gras. Momifié par le lubrifiant la moto est à peine touchable. Une forme sculpturale apparaît ainsi sur fond d’impuissance mécanique et de frustration consumériste. Un double mouvement impossible fait problème, à la fois de combustion motrice et de consommation hédoniste.
Ce que Jacques Rancière appelle le « régime esthétique de l’art » désigne les conditions d’existence et d’identification des œuvres d’art aujourd’hui, marquées par l’indistinction de l’art et du non art. Or, nous voyons à travers les formes motorisées de Reist et Faulon s’ouvrir le jeu de ce qu’on pourrait appeler un « sur-régime esthétique ». Il s’agit d’un fonctionnement des œuvres qui résout le problème de l’indistinction en montrant qu’il ne se règle pas en s’arrêtant à la nature des formes, des médiums et des contextes, mais en s’intéressant aux forces des choses et à leurs dynamiques. Les moteurs que l’on rencontre dans les œuvres couplées des deux artistes font entendre et voir cet enjeu. Leur problème n’est pas de jouer à définir l’art en signant des objets de supermarché, il est de transformer notre expérience du banal en le faisant fonctionner autrement, afin de produire des formes d’autonomie paradoxales et provisoires qui se manifestent au cœur même des lieux et des choses les plus aliénés et relégués. Il devient alors possible de jouir d’une forme de faiblesse, dans la mesure où une puissance de mouvement et de vie s’y fait sentir ou s’y reconstitue.