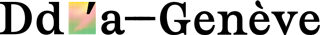Laurent Faulon se livre à un dépeçage méthodique – au sens symbolique, bien sûr - de l’être humain civilisé. Le théâtre libidinal, sur la scène duquel les rituels du social se jouent, est l’emplacement de son travail. Spectateur de l’une de ses actions ou témoin de l’une de ses situations, vous êtes pris du sentiment troublant de l’accoutumance. Vous reconnaissez les lieux, les objets, les images… Vous les reconnaissez tellement bien que leur présence déplacée vous trouble : quelle familiarité ! Votre vie s’est constituée en compagnie de toutes ces choses muettes. Sans même y penser, vous les avez intégrées dans votre environnement. Tous les éléments matériels utilisés par l’artiste proviennent du fatras qui constitue votre vie même ; cet amoncellement de choses qui vous entourent, dont votre corps se pare et se remplit. Toutes ces choses agglutinées autour de votre corps, qui viennent s’agréger à la surface de votre peau jusqu’à vous pénétrer par tous les orifices pour irriguer vos organes, et dont vous ne semblez pas pouvoir vous séparer. À dire vrai, puisqu’il vous faut bien l’avouer, vous ne sauriez pas vous défaire de la compagnie pourtant étrange de ces objets de consommation courante, ces machines diaboliquement animées qui entravent votre vie en vous donnant le sentiment absolument fallacieux de la liberté. Tous ces fétiches que la civilisation invente pour rassurer l’être humain face à sa finitude. Toutes ces possessions que la famille suicidaire décrite par Michael Haneke dans son film Le Septième continent (1989) va méthodiquement détruire avant de se donner collectivement la mort. Pour disparaître en ne laissant aucune trace. Pour nier la valeur des choses matérielles - jusqu’à l’argent jeté aux chiottes, tabou absolu. Ultime revanche contre le consumérisme avant l’anéantissement nihiliste. La mort ne les libérera pas.
L’artiste n’est pas un chaman ; il ne vous soulagera pas de ce sentiment désagréable d’être durablement soumis à l’ordre économique et social. L’artiste n’est pas un moraliste ; il ne vous indiquera pas comment bien penser. L’artiste est un catalyseur des angoisses qui vous relient au cauchemar collectif. Il fait tout remonter à la surface. Avec très peu d’éléments, judicieusement disposés dans l’espace, il vous convie à une expérience perturbante et pourtant jamais traumatique. Vous reconnaîtrez beaucoup de ce que vous auriez pu vivre vous-même.
Laurent Faulon privilégie les lieux abandonnés, les ruines dévastées, les bâtiments en chantier, les espaces désacralisés, pour inviter ses spectateurs à une déambulation exploratoire, à la rencontre de situations étranges. Le malaise vient de l’accouplement et de la mise en mouvement des choses. Paysage de fantaisie. Des saucisses vibrantes sortent de matelas. Vieux matelas tachés, posés au sol. Eventrés. Champignons poussant dans la moisissure. Phallus évoquant de terribles prises de pouvoir. Toutes les figures d’autorité sont ici convoquées pour subir en retour l’indignité de leur prétention à prendre le contrôle des vies.
Virulence libertaire de l’art qui seul, avec la poésie et la philosophie, ses compagnes, sait vous inviter à considérer froidement les conditions de vos enchaînements et la nécessité d’y échapper. L’art, au tournant du court vingtième siècle et de l’incertain vingt-et-unième, travaille à fouiller le paysage dessiné par le désastre administré. Vous êtes contemporain de la prise de conscience planétaire d’un drame annoncé et pourtant indéterminé : tout a été mis en place par la révolution industrielle pour permettre la fragilisation extrême de l’environnement protecteur qui autorise la vie. Et pourtant, le processus d’humanisation est inachevé. L’art participe à ce projet d’émancipation. L’un de ses vecteurs est la pensée critique.
Vivant au cœur de la société mais agissant dans ses marges, l’artiste situe son activité nécessairement paradoxale à l’embranchement des trajectoires individuelles et du projet collectif. Il cible les lieux où viennent s’accumuler les névroses en recherche d’un vain réconfort.
Dans le chœur d’une chapelle, une machine de nettoyage industriel pivote autour d’un axe, en brassant au sol l’alcool qui remplit ses réservoirs habituellement dévolus à la chimie hygiéniste. Auréole. Le dispositif pulsionnel de la religiosité est battu en brèche. Vous tournez en rond dans la nuit - et les vapeurs anxiolytiques vous enveloppent sans fin. La situation est improbable. Elle était pourtant présente, à l’état de potentiel, dans cet hospice, ce mouroir où la religion prétendait sauver les âmes là où la médecine cherche encore à retarder l’échéance.
L’angoisse engendrée par la civilisation industrielle, la brutalité suggérée par toutes ces formes conçues par des ingénieurs, la dangerosité contenue potentiellement dans toutes les arêtes vives des objets sortis des usines, le potentiel de mort véhiculé par toutes ces machines motorisées constituent un environnement mentalement traumatique pour l’espèce humaine. Le progrès engendré par son évolution, malgré la nécessité légitime d’améliorer ses conditions d’existence, a fabriqué un monde désensibilisé, où les formes de vie qui furent complices sont aujourd’hui radicalement séparées. Dans son évolution, l’humanité avait-elle un autre choix que celui de provoquer ce chaos de béton, d’acier et de plastique ? Cet enchevêtrement de fils électriques, de sacs poubelles et de cheveux ? Ce magma de sang, de merde et de bitume ? Pouvait-elle faire autrement que de constituer ces gigantesques poubelles terrestres et maritimes, à ciel ouvert, sur des kilomètres carrés, où viennent s’amonceler dans la puanteur tous les rebuts de ses maladroites activités quotidiennes ?
La machine n’est plus célibataire, elle est orpheline. Il convient désormais de la soigner, comme une extension du corps. Laurent Faulon la recouvre d’onguent, en larges empâtements. Désirons sans fin. Il applique une épaisse couche de vaseline sur toutes les surfaces de la motocyclette et du canapé, des parpaings et de la télé. Tout cela qui venait s’accumuler dans la maison est maintenant exposé comme figé dans la gangue du désir. Pommade anesthésiante. Odeur entêtante de mouroir. Tenter de s’en saisir, c’est faire l’expérience de la viscosité rebutante de la graisse. Trop aimable, et comme un signal ou un mode d’emploi, l’artiste a disposé des serviettes blanches à proximité… Vous vous en sortirez bien, cette fois-ci. Il vous suffira de vous essuyer les mains - comme d’habitude.
À Hiroshima, dans le hall de la succursale de la Banque du Japon, qui fut le premier dispensaire où vinrent s’accumuler les cadavres après l’explosion de la Bombe, à 380 mètres de l’hypocentre, il expose en ligne des mobylettes et scooters recouverts de graisse industrielle. Machines comme des insectes figés dans leur membrane de miellat. Vains premiers secours sur la peau des choses. La vie a continué, ici aussi. Mais rien ne sera plus comme avant. Vous êtes prévenu du désastre annoncé par la science. La brûlure sera extrême. Nulle protection n’y remédiera.
Plus loin, un carton est rempli d’eau, jusqu’à ras bord. Cela semble impossible de faire contenir autant de force et de masse liquide dans du carton. C’est une expérience. Comme un savoir contenu - et qui déborde. C’est un équilibre fragile. Une tentative de parvenir à une masse critique, un point de rupture.
Mein Ferrari : en un shopping radical, suivi par le public dans les couloirs du supermarché, l’artiste achète toutes sortes d’objets rouges, passe à la caisse puis se dirige vers le parking où il enduit méthodiquement de ketchup la carrosserie blanche d’une automobile banale. Rituel énigmatique. Sans explications. La souillure sera toujours rejouée. Rien de ce qui vous entoure n’en sera épargné. Rien de ce qui est sanctifié par la civilisation industrielle ne devra échapper à l’infamie. Les surfaces ripolinées du capitalisme seront corrompues par toutes les déjections possibles, issues du tout-à-l’égout de ses usines. Quels rites, nécessairement archaïques, devrez-vous inventer pour vous rédimer du servage ?
Laurent Faulon vous invite à un banquet désolé. Pâtisseries avariées aux couleurs pourtant alléchantes, fichées au bout de piques ou d’étais de chantier. Préparations alimentaires distribuées à même le ciment et dévorées par un petit cochon. Comment vivre ensemble ? La nourriture est-elle vraiment ce qui rassemble et permet de faire communauté ? Le gavage des corps par l’industrie agro-alimentaire et le modelage des physionomies par la technique médicalisée sont des étapes dans la domestication. La fabrique de l’être humain consiste à lui montrer les limites.
Cul nu, il s’assied sur des gâteaux posés au sol. Adulte confondu avec l’enfant. Transgression de l’interdit. Acte insensé et sans conséquences. L’individu que vous êtes osera-t-il s’opposer aux figures multiples de l’autorité ? Avec la politesse du désespoir, un effet comique qui vient tempérer le sordide, Laurent Faulon met en scène l’isolement opéré par la société. Il y a du burlesque dans ces rites bachiques. Nu, en chaussures de sport, il saute de tables en tables. Performance absurde, relativement périlleuse. La dépense du corps consiste à habiter l’abîme ouvert par l’existence.
Explosions d’intensité libidinale. C’est ça ou mourir ? Les patrons et les gouvernements vous auront dressé à jouir de l’aliénation. Seule est envisageable la rébellion contre cet état de fait. Qui vous a dit qu’elle était impossible ?
Distributeur Les Presses du Réel