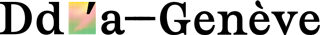Le travail de Laura Thiong-Toye est peut-être avant tout un terrain de jeux. Les images disparates, parfois antagonistes – sélectionnées dans la vie quotidienne, dans des livres ou des bases de données – semblent s’y rencontrer gaiement, comme sur une île où presque tout est permis. Une île qui rappelle celle de la Réunion (d’où la famille de l’artiste est originaire) où cohabitent l’hindouisme populaire du Sud de l’Inde, le christianisme européen, les croyances malgaches, est-africaines et les courants religieux de la Chine, de l’Inde musulmane, des Comores et de Mayotte1 . La grande variété des métissages vécus à la Réunion – acculturation, analogie (correspondance), réinterprétation (manipulation des matériaux symboliques)2 – est ainsi reconduite en peinture.
Plus qu’un simple métissage, ils donnent à penser l’idée de « créolisation » – selon la définition d’Edouard Glissant3 – dans la mesure où le résultat de la mise en contact des éléments offre une expression inédite et imprévisible. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les procédés utilisés par l’artiste sont ceux du hip-hop : sampling (sélectionner, mais aussi répéter, se réapproprier), rap (au sens de conversation)4 , scratch mixing (superposition d’éléments sonores hétérogènes)5 . L’espace du tableau offre ainsi la possibilité de faire dialoguer des éléments issus de catégories socio-culturelles diverses et qui n’auraient jamais pu, ailleurs, se retrouver. Ce travail de recontextualisation nous rappelle que nous existons surtout par les relations que l’on tisse avec les autres et qui se rejouent sans cesse.
En ces temps de « surabondance d’images », les discussions souvent ludiques entre les éléments du tableau – sorte de fête de famille où l’on inviterait les cousins éloignés – offrent une proposition décomplexée sur l’histoire de l’art où le marrant, le moche, le sacré, le beau et le subtil cohabitent. La mise à plat des valeurs traditionnelles de l’art – distinction entre high art et culture populaire, goût bourgeois, technicité, sérieux, originalité ou sincérité – évoque les « thrift paintings » de Jim Shaw et le mouvement « Bad Paintings » qui visaient justement à défier ces valeurs. Cependant, c’est peut-être à la contre-tradition contemporaine du modernisme – jeux d’images surréalistes, dada, pop art – qui prônait le non-sérieux, l’irrévérence et l’impureté qu’il faut peut-être préférer se référer.
C’est également à l’aulne d’une nouvelle génération de peintres, comme Paul Wackers, Matthew Palladino ou David Shrigley, que l’on comprend les motifs, l’appropriation de l’environnement visuel ainsi que le virage décidément graphique d’un travail qui s’est éloigné de la peinture à l’huile « thrift » pour employer l’acrylique, le spray et le scotch. La décomplexion de cette génération qui assume ses envies et ses sujets sans autre justification que sa volonté propre nous rappelle étonnement les mots de Véronèse qui décrivait sa profession ainsi: « je peins et je forme des figures », avant d’ajouter : « nous autres peintres, nous jouissons de la même licence que celle dont jouissent les poètes et les fous ».
Texte d’exposition de Jeremy Gafas
- Lire aussi l’article de Irène Languin, Tribune de Genève, 2020