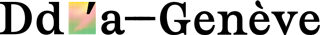↳ Cartes postales
O.A.F. J’aimerais te proposer de partir de ton exposition pour aborder ensuite des questions plastiques et sociales plus larges. Ton exposition à l’Aargauer Kunsthaus s’ouvre sur ce que tu as appelé en préparation à notre entretien un ‹ espace-pivot ›, un espace-lien pourrait-on peut-être aussi dire, entre un espace consacré aux archives d’État et à ton lien, ton accès à celles-ci d’une part, et d’autre part un espace dévolu à des archives personnelles et ta remise en jeu d’une histoire intime. Dans ces quatre espaces, il est question de la colonisation, puis de la décolonisation de l’Algérie dans ton rapport en tant qu’artiste-chercheuse aux archives de cette histoire. Une carte postale ouvre l’exposition. Comment en es-tu venue à t’intéresser aux cartes postales en tant que sujet et comment s’articule selon toi leur place entre les archives d’État et les archives personnelles ?
C.K. L’objet carte postale m’a semblé intéressant lorsque je commençais à penser à la circulation au sein de l’exposition. L’espace dans lequel la carte postale est présentée est dans tous les cas un espace de transit, il permet d’accéder aux autres espaces qui composent cette exposition. Dès lors, j’ai cherché un objet qui pouvait faire entrer les publics dans l’exposition, comme on entrerait dans une recherche. Je cherchais un objet qui évoquait toutes les autres présences dans l’exposition. Cette carte postale représente aussi un moment important de l’histoire qui m’intéressait. Elle est écrite quelques mois après la proclamation de l’indépendance de l’Algérie, en décembre 1962. Elle est écrite par mon grand-père, un géomètre suisse employé d’une entreprise française, à l’attention de ma grand-mère qui, elle, est algérienne. Mon grand-père exprime sa difficulté à ramener leurs biens, leurs affaires, leurs objets, de l’Algérie à la France, car l’embarcation est rendue difficile, notamment par le rapatriement simultané de milliers de personnes et d’objets qui, à l’origine, avaient transité en sens inverse, envoyés par l’État français. Cette carte postale fait donc déjà le lien entre un moment significatif de l’histoire, qui est la proclamation de l’indépendance, et une histoire familiale puisqu’il s’agit d’une carte postale, au dos de laquelle mon grand-père a rédigé ces lignes adressées à ma grand-mère. C’est aussi un objet simple, humble, quasi banal, pensé pour traverser des frontières, pour apporter des nouvelles aux proches. Un objet simple dans sa forme qui peut contenir des moments d’histoire assez forts. Il devient ici un objet-pivot, témoin. C’est le seul objet qui est présenté presque tel qu’il est, il n’est pas transformé. Le paysage qui est représenté, c’est le Cap Carbon, un site touristique en Algérie. C’est un paysage archétypal de carte postale. C’est un objet qui raconte l’histoire d’une famille qui va passer de l’Algérie à la Suisse, de leurs biens, de leurs archives, des archives étatiques, des biens de la France qui sont rapatriés et des objets d’art qui m’ont particulièrement intéressée dans ma recherche. Cet objet est le point de départ d’une fiction. Il situe le point de départ de l’exposition et de la recherche et c’est presque une méthodologie narrative. Il marque le début de l’histoire que j’ai choisi de raconter.
O.A.F. Cette carte représente un paysage. Comment as-tu pensé à la question de ce paysage qui ouvre ton exposition ?
C.K. La représentation de l’ailleurs est une composante majeure de la carte postale. Cette dernière est un objet qui démocratise et fait circuler des photographies. Elle est ainsi très ambiguë. La carte postale est à la fois un immense outil de propagande pendant la période coloniale, elle crée l’ailleurs, elle participe à l’imaginaire colonial, le construit en partie, elle s’introduit dans les espaces domestiques, elle fait partie de l’intimité des gens, collectivement. Et puis en même temps pour moi c’est un moyen d’accéder à une histoire personnelle. Je me sens aussi attachée à ce paysage car il y a peu d’images qui rappellent les lieux de rencontre ou de vie de mes grands-parents et de leur vie avant leur transfert. Il est évident pour moi que le fantasme fait partie de la recherche, comme pour beaucoup de personnes liées à un territoire mais qui n’y ont pas d’imaginaire ancré. Surtout dans un territoire qui n’existe plus tel qu’il est représenté là. Enfin, dans cette représentation en particulier, c’est un paysage qui n’est pas situé. Il est peut-être méditerranéen. C’est surtout un bout de terre et un bout de mer, sans nom.
↳ Timbres
O.A.F. Faisant suite aux cartes postales, ta recherche t’a menée à t’intéresser aux timbres collés sur celles-ci. Les signes et les symboles contenus dans ces timbres sont rejoués dans ton exposition, dans la partie où tu questionnes tes archives personnelles. Une série de tableaux, au sein de laquelle tu as repris certaines des formes trouvées sur ces timbres sont présentés au public. Quel rapport entretiens-tu avec l’abstraction comme catégorie d’une production artistique, puisqu’en un sens il s’agit d’abstraire — au sens d’isoler — des formes pour les transposer et les rejouer ailleurs ? Et plus largement quelle méthode as-tu mise en place dans ta pratique, puisqu’il semble que le transfert des formes soit un élément important ?
C.K. Le timbre est récurrent car c’est l’une des seules sources visuelles à laquelle j’ai eu accès. Dans mes archives familiales, j’ai retrouvé énormément de lettres mais très peu de photographies. Une des seules images qui me reste c’est le timbre. Ce sont des objets intéressants car ce sont des compositions graphiques, emplies de détails et de signes surprenants. Mais je ne dispose que de la moitié des timbres puisque je ne dispose que de la moitié des lettres, seules les lettres de mon grand-père ayant été conservées par ma grand-mère, et non l’inverse. Ces timbres sont aussi et à nouveau des images de propagande, des commandes d’État, chargées de sens. Le timbre est à la fois une image étatique mais aussi une image secondaire de par son format minuscule fait pour le voyage et le passage des frontières. Elle s’inscrit dans un rapport d’intimité au passé.
Le timbre doit être léché, touché dans tous les cas, il y a quelque chose dans le geste même auquel nous oblige le timbre qui incarne une situation d’intimité. Les timbres d’archives avec lesquels j’ai travaillé comportent une imagerie coloniale. J’ai décidé de ne pas les redonner à voir. Je préférais spéculer sur une série de nouveaux timbres, un réagencement et créer des paysages spéculatifs à partir de formes existantes. L’abstraction devient dès lors une stratégie pour déjouer le visible, pour repenser la visibilité des images, rediriger l’attention. Je convoque des vrais formats qui existent — le timbre, la carte postale — notamment dans un imaginaire collectif, mais le contenu peut être inattendu et il entre potentiellement en collision avec la fonction de l’objet, il crée un doute sur la véracité de l’objet. C’est aussi une stratégie pour ne pas sacraliser ce qui est en soi une archive qui, bien que petite, transporte une forme de violence avec elle. Le timbre est une production à grande échelle d’une image minuscule, un objet humble et quotidien, qui a une réelle fonction dans la société. Les timbres semblent être de petits gestes, mais ces petits gestes prennent une ampleur conséquente puisqu’ils sont reproduits massivement. Si on envisage l’exposition comme une narration, il me semble important de choisir des objets auxquels on peut s’identifier simplement et qui ouvrent un chapitre de l’histoire.
↳ Archives
O.A.F. Ton exposition met en scène l’accès que l’on a — ou pas — aux archives. On peut voir ton travail comme faisant partie d’une approche critique et plastique plus générale sur les enjeux de l’écriture de l’histoire. Pourquoi as-tu décidé d’aborder les archives en particulier ? Qu’est-ce que cela dit des institutions dans lesquelles nous évoluons en France et en Suisse ? Et est-ce que tu rencontres des difficultés à porter ces sujets en Suisse ?
C.K. J’ai toujours travaillé avec des matériaux, des objets, des éléments déjà existants, et j’envisage ma pratique comme un moyen d’en pointer certains tout en en écartant d’autres. Travailler avec l’archive est un moyen de produire du sens en redirigeant cette attention. On pourrait questionner ce qui fait archive ou non de façon générale, mais dans l’exposition le dénominateur commun est le temps et les géographies auxquels appartiennent les documents réunis. Les archives sont conservées en amont dans des lieux en revanche très différents : des espaces nationaux d’une part et un espace intime et familial d’autre part. En France, l’accès aux archives étatiques pour la consultation est relativement simple, mais c’est l’utilisation des archives (les filmer, les sortir du lieu, les copier) qui mène dans des méandres administratifs. Ce sont à mon sens des procédures et des civilités d’accès. En conscientisant mes privilèges dans cet accès, j’adopte une posture subjective d’artiste-chercheuse qui analyse tous les micros-gestes nécessaires à l’accession à une image dont on avait spéculé l’existence. Mes documents d’identité me permettent de circuler librement dans ces lieux, d’y entrer sans trop de questionnements ni de difficultés.
En ce qui concerne les archives intimes, il y a des politiques internes d’accès : qui dans la famille conserve quelle lettre ? Quelle carte ? Je ne suis qu’une personne d’une famille nombreuse qui va exposer une part d’intime, articuler ces objets selon ma compréhension, ma lecture des événements familiaux. Cela représente aussi une complexité.
Des gestes similaires s’inscrivent dans ces deux typologies d’objets : observer, trier, reproduire et remettre en jeu ou transférer. Comme ma recherche dans les archives d’État se concentrait sur les traces des monuments transférés de l’Algérie vers la France – des sculptures commémoratives de l’histoire française, comme le duc d’Orléans sur la Place du Gouvernement et Jeanne d’Arc en face de la Grande Poste à Alger –, j’ai aussi relevé que peu après la déclaration de l’indépendance en Algérie, on trouve des archives étatiques qui documentent l’histoire pendant encore plusieurs mois, alors qu’officiellement certains centres disent ne rien conserver de cette période. Je n’ai pas travaillé avec des centres d’archive en Suisse, puisque je me suis intéressée au mouvement des monuments transférés et que le territoire suisse n’est pas directement concerné, mais il devient tangible que beaucoup de structures qui soutiennent aujourd’hui les artistes ont des attentes concernant des liens qui sont à faire avec l’histoire suisse.
O.A.F. À mon sens, ton travail invite justement à se projeter dans cette histoire qui, de par la proximité entre la Suisse et la France, est proche, mais en pensant les aspects de leurs histoires coloniales spécifiques et situées sur des territoires distincts.
C.K. Oui ce sont ces fragmentations, ces histoires spécifiques mais démultipliées qui m’intéressent. Je travaille avec ce qui existe et ce qui existe autour de moi et qui me concerne passe en l’occurrence par la France. Il me semble aussi que des personnes françaises et algériennes vivent en Suisse et peuvent reconnaître leur histoire. J’imagine surtout les expositions comme des prétextes pour commencer à raconter des histoires. Je suis moins fascinée par ces archives — surtout pour les archives d’État qui sont toujours des images de propagande, constituées dans un contexte colonial dans lequel ce rapport de force est une dynamique sans cesse rejouée —, que par le contexte d’accès à ces archives. Ces espaces sont souvent cliniques, parfois désuets, des ordinateurs obsolètes y gisent, attendant que des curieux viennent taper des mots clés absurdes sur les touches de leur clavier dans le but de mettre la main sur des images ou des documents qui étaient en premier lieu fantasmés. C’est raconter cette expérience de l’image et des mots qui m’intéresse et que j’essaie de transmettre.
↳ Généalogie
O.A.F. Il y a une généalogie qui transite par les femmes dans ton travail. C’est grâce au geste de conservation, d’archivage par ta grand-mère que nous avons accès à une histoire intime, à l’histoire dont tu es le produit. Qui reste audible ? Quelles voix sont gardées en mémoire ? Qui prend soin et qui transmet ? Autant de questions qui émergent de ce geste. Comment s’inscrivent tes propres gestes dans cette histoire ?
C.K. Je spécule dans ma recherche et dans mon histoire, que seule ma grand-mère aurait conservé ces archives familiales. Peut-être que c’est plutôt le soin à l’espace domestique, à l’espace de la famille, qui se répercute sur le soin apporté à ces objets, ces documents, qui aujourd’hui sont pour moi des archives. Les lettres de ma grand-mère ne sont pas présentes matériellement, mais le simple fait que l’on lise ce qui sont en fait les réponses de mon grand-père à ses lettres rend déjà compte de leur présence et de leur existence. C’est tout ce soin qui constitue un corpus et une mémoire à partir desquels on imagine, on spécule, on raconte des histoires, les histoires des gens. C’est la possibilité d’une fiction, l’envie de continuer à raconter une histoire, de la partager, d’accepter la part de subjectivité qui anime la recherche. Tout l’équilibre consiste à transmettre un certain nombre d’informations et à garder une histoire, faite d’images, la plus ouverte possible. L’idée de montage est ainsi prégnante dans mon travail. La plupart du temps je travaille seule, ou en petite équipe, je m’éloigne des espaces d’art pour approcher des lieux où des formes transitent mais sans que le rapport à l’image ne soit forcément central, je ne travaille qu’à partir de matériel existant, ce sont des gestes qui s’éloignent d’une relation à la production de l’ordre du spectaculaire.