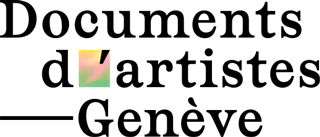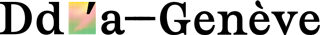Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire.
Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art.
Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture1 .
La première statue que les colons français plantent en Algérie (1845) allait être celle qui ouvrirait le chemin des convois du retour vers la France au moment de son indépendance (1962). Elle représente le duc d’Orléans, fils de Louis-Philippe, le dernier roi de France. C’est aussi comme ça qu’ils ont forcé la terre algérienne. Avec le bronze.
Mort dans un accident de la route à Neuilly-sur-Seine, le prince qui s’est illustré dans la conquête de l’Algérie trône ironiquement avec son cheval au milieu du rond-point. Le métal se conjugue encore au présent. Avant, il siégeait le cœur d’Alger, vigile de la place du Gouvernement et de sa mosquée. Comme des centaines d’autres2 , ce symbole idéologique de l’Algérie colonisée occupe l’espace public français3 .
À l’heure où la France commence à restituer les œuvres qu’elle a pillées dans ses colonies, Camille Kaiser s’intéresse à un mouvement inverse. Qu’en est-il des statues et des monuments avec lesquels le gouvernement français a violé le sol de l’autre côté de la Méditerranée ? Comment assène-t-on sa propriété avec ce que l’on appelle la culture. Pouvoir doux, pouvoir dur.
Le film small gestures, grand gestures nous introduit dans les archives photographiques et audiovisuelles de la Défense à Ivry-sur-Seine (ECPAD). Cette valse muette des mains après une lente appréhension des lieux, raconte aussi les remparts de silence pour notre histoire. Avec pour seule voix, une bande son qui grince et gratte. Les visages responsables de ces déplacements sont en hors champs. Et, aussi petites qu’elles soient, les archives portent une violence qui peine à prendre la lumière.
D’autres gestes pourraient disloquer ce monde immobile4 de métal et de pierre. Devenir une mémoire pour l’oubli5 . Les statues peuvent mourir aussi.