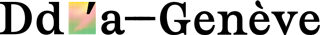Osons le dire clairement : nous, spectateurs, habitants d’un monde qui nous est légué et sur lequel nous accomplissons chaque seconde des actes qui relèvent de notre absolue responsabilité, nous tous donc, arrivons ici comme en retard : l’histoire a déjà commencé. Les films et les installations de Pauline Julier ont ce premier mérite : celui de nous placer face à nos effets, devant un paysage qui a déjà entamé sa mue. S’il y a film, s’il y a œuvre, c’est peut-être qu’il n’est pas encore trop tard.
La nature ne nous est pas si « naturellement » offerte au regard. La voir, c’est se frayer un chemin dans une jungle d’antagonismes. La voir, c’est aussi apprendre à la regarder au-delà de sa beauté intrinsèque, par delà la sidération qu’elle offre, mais sous la lumière du danger que nous représentons pour elle, la voir tel un système fragile, complexe, que nous ne cessons d’abîmer.
Le travail de Pauline Julier sert justement à prendre acte de ce renversement de paradigme que souligne Bruno Latour (dans Face à Gaïa, La Découverte, 2015) : la Nature ne se contemple plus de la même façon que nous l’avons fait, et cru naturel de le faire. Elle n’est plus seulement le décor, la surface sur laquelle nous faisons nos affaires, elle est ce lieu qui interagit avec nos actions, car elle est là où nos actions inévitablement aboutissent. À notre folie, notre aveuglement, elle ne peut répondre désormais que par la furie, ce que nous nommons son dérèglement, et il est tout à fait possible, envisageable, que cela ne laisse rien, à terme, derrière nous, derrière elle, si nous n’en prenons pas acte.
Les films de Pauline Julier sont une façon de déconstruire la contemplation pour la remplacer par des suites d’interrogations. Ce n’est pas qu’il ne faut plus filmer la Nature, refuser de la contempler, mais l’urgence est ailleurs : il faut réapprendre à la regarder. Peut-être par en-dessous, pour y voir au travail les forces souterraines qui mettent en tension son existence même : la contemplation ne peut plus être un recours, une façon de se secourir du monde, une issue, un point de fuite, tant le monde industriel impose à cette même Nature une pression devenue intenable. Et c’est précisément depuis cet intenable, pluriel, divers, aussi bien politique qu’économique, philosophique ou scientifique, moral ou esthétique, que les films de Pauline Julier s’adressent à nous.
Mais c’est aussi un enjeu poétique, un enjeu de cinéma : comment accéder aux plus petites échelles de la nature? Comment accéder à la matière noire, à la physique des saveurs, aux interactions les plus faibles? Le langage des films est savoureux : c’est celui de la science, mais pas seulement. Ce sont déjà des images.
« Il faut imaginer la connaissance comme une île » : la physique des hautes énergies a besoin d’images, de métaphores, d’un méta-langage. Comme l’anthropologue Philippe Descola filmé par Pauline Julier, a besoin d’apprendre à regarder pour pouvoir y voir. Une image d’un côté, une question neuve de l’autre ; et au centre une artiste. Qui rassemblent ces questions, qui rencontrent ces doutes. Ainsi, quand bloquée dans un hôtel d’aéroport pendant l’éruption d’un volcan, discutant avec un paléobotaniste chinois, lui aussi condamné à attendre que la colère de la nature passe, ce dernier lui explique cette chose, essentielle, mais que l’on ne savait pas: il n’existe pas d’idéogrammes pour dire le mot « paysage ». Dans la langue du paléobotaniste, le signifiant paysage se compose de deux signifiants maîtres : Vent-Lumière. C’est la plus belle définition du cinéma.
Ce n’est pas une carte postale du plus vieux paysage du monde que cherche Pauline Julier, mais une archéologie qui nous permette de nous projeter dans le futur. Ce qui commence à nous manquer, semble-t-il. Il n’y a rien de moins naturel que la Nature, nous dit-elle. Il n’y a rien de plus complexe que de la décrire, donc. Et plus encore est le défi de la filmer, c’est-à-dire la regarder à la hauteur des enjeux qu’elle nous pose, à nous qui la bouleversons sans lui demander la moindre autorisation.