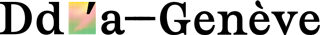« Who sold their skin ?» Considéré de manière littérale, le titre interrogatif de l’installation de Lou Masduraud pose d’emblée une double ambiguïté. Le « their » indique-t-il un neutre ou un pluriel? Si l’on opte pour l’hypothèse du pluriel,
le possessif engage à envisager la peau comme une propriété collective, un commun. Hypothèse sérieusement considérée par la sociologue Elspeth Probyn qui se deman- dait, à travers une reformulation de Donna Haraway: « Pourquoi notre peau devrait-elle s’arrêter à la limite de nos corps? ». Dans son livre Outside Belongings, Probyn définit l’appartenance comme le fait d’être saisi par les manières d’être d’autres que soi et par des désirs de devenir autre. L’appartenance ne convergerait pas vers un centre, mais se manifesterait à l’extérieur, au niveau de la peau, qui devient tissu collectif de singularités. En ce sens, l’appartenance n’est jamais acquise, mais toujours de l’ordre du désir, d’un devenir. Si la piste du « their » comme pronom neutre paraît plus plausible sur un plan physiologique, elle exprime la même réticence à assigner une identité dans le système binaire du genre, voire dans celui de la partition humain/animal. La question posée par ce titre devient ainsi de plus en plus rhétorique ou abyssale, puisque les indices qui permettraient d’y répondre sont sciemment troublés. D’autant plus que l’équivoque se prolonge dans l’attribution des variables de la transaction commer- ciale. S’agit-il d’imaginer un individu prêt à vendre sa propre peau comme certaines personnes désespérées monnaient de gré ou de forceleurs organes? Ou alors le pronom relatif fait-il référence à un marchand spécialisé en trafic d’organes?
L’œuvre elle-même persiste à tenir en échec cette approche forensique. Un réseau d’os se déploie dans l’espace. Il suit l’architecture, s’accumule dans des boîtes, créant des intensités variées. De longs segments s’échappent, d’autres, plus petits, sont pris au piège, arrêtés, enracinés. Le squelette humain est suggéré, puis mute, s’extirpe du familier. Des morceaux d’étoffes de chemises d’employés de bureau qui emmaillotent certaines sections de la carcasse incriminent un statut social et des relations de pouvoir.
Au-delà d’une représentation de la violence abstraite que renferment les bilans comptables, l’installation de Lou Masduraud indique, dans un passage de l’économique à l’écologique, une survivance du calcium. Comme une plante grimpante d’intérieur qui se conforme à la pièce dans laquelle elle est placée, les ossements suivent le relief de leur environnement. Ce faisant, ils témoignent d’une capacité d’adaptation et d’harmonisation: un employé modèle en somme, qui a internalisé les exigences et les valeurs de son entreprise au point d’y laisser sa peau, de devenir indiscernable des canalisations et tubulures de son lieu de travail. De cette aliénation totale naît pourtant une émancipation à sa propre structure interne, un fantasme de corps-sans-organe. Cette car- casse rhizomatique ne forme plus un corps organisé et hiérarchisé. Parce qu’elle déroge à l’identification, elle devient inexploitable. En redoublant son carcan, elle le parasite, tout en s’offrant comme milieu possible pour d’autres formes de vie.
Dans l’histoire de l’art, cette prise d’assaut de l’architecture par une ornementation de fig- ures hybrides et monstrueuses a été définie comme le propre de l’art grotesque. Une tradition que Lou Masduraud porte avec son travail qui fait dialoguer l’effroi de structures de domination et de leur tendance centripète à exploiter, emboîter et dresser, avec les forces centrifuges satiriques qui inventent des agencements mutants et extravagants. Les différences entre endo- et exosquelette, comme métaphore d’autres binarités structurantes, se dissolvent alors en une effervescence de vie et de désirs.