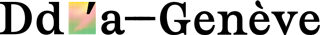Notre époque se définit par le flot incessant d’images innombrables qui, quotidiennement et comme jamais auparavant, nous parviennent par le biais de la télévision, d’Internet et des téléphones portables. Cette tendance ne cesse de croître. Mais que voyons-nous exactement ? De quelle façon traitons-nous cette surcharge d’informations visuelles ?
C’est à ces mécanismes que Jérôme Leuba s’intéresse. Il étudie la construction des images, leurs significations, et remet en cause les structures de pouvoir qui s’y manifestent, que ce soit dans un contexte politique, individuel ou artistique. Il crée des situations totalement insignifiantes qui, pourtant, recèlent toujours quelque chose d’étrange, voire de désagréable. Ses œuvres déconcertent et, sous leurs apparences anodines, réveillent le souvenir de violentes images de guerres ou de catastrophes, profondément ancrées dans notre conscience collective. battlefield #58/open window (2009) en est un exemple frappant : à un étage élevé d’un immeuble de verre, un homme se penche à une fenêtre ouverte – une situation banale. Pourtant, la façon dont l’image est « agencée » évoque immanquablement les attentats terroristes du 11-Septembre et ces photographies d’hommes et de femmes qui, du haut des tours du World Trade Center, appelaient à l’aide, à grands renforts de gestes, avant de finir, désespérés, par se jeter dans le vide. Ces images, reproduites des milliers de fois dans les médias, sont gravées de manière indélébile dans notre mémoire – le lieu même d’intervention des œuvres de Jérôme Leuba.
Continuellement dans un état d’entre-deux et d’ambiguïté, les images qu’il fabrique ou utilise ne se laissent jamais réduire à une interprétation univoque. En agissant ainsi, il renonce consciemment au spectaculaire, recourant à ce que Roland Barthes nomme le « signe incertain »1
. Pour cela, il met en scène des espaces vides qui confrontent les spectateurs à leurs propres images, représentations et – surtout – préjugés. Ce procédé renferme une composante très politique dans la mesure où il est le seul à provoquer un nouveau mode de lecture de l’image ainsi qu’une « émancipation du spectateur », selon l’expression de Jacques Rancière : « L’émancipation, elle, commence quand on remet en question l’opposition entre regarder et agir, quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports … du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la sujétion. Elle commence quand on comprend que regarder est aussi une action qui confirme ou transforme cette distribution des positions. »2
Dans ses œuvres, Jérôme Leuba révèle ces changements dans la façon de regarder, comme le démontre battlefield #19/if you see something, say something (2005). L’œuvre ne consiste en rien d’autre qu’en des valises et des sacs vides – une fois encore, des objets du quotidien. Pourtant, lorsque ces choses banales surgissent dans une salle d’exposition, ces contenant, posés là, sans propriétaire, provoquent de vives réactions. Craignant la présence d’une bombe, les visiteurs inquiets alertent le personnel de surveillance. C’est ce qui advint dans le cadre de l’exposition Shifting Identities – (Schweizer) Kunst Heute au Kunsthaus Zürich3
. Si l’exposition avait eu lieu avant le 11-Septembre et sa vague consécutive de peur et d’hystérie vis-à-vis du terrorisme, les réactions auraient certainement été tout autres. Pourtant, depuis cet événement, notre comportement et notre perception se sont fondamentalement transformés ; c’est sur cela que joue Jérôme Leuba, laissant à l’observateur le soin de lier « ce qu’il voit à bien d’autres choses qu’il a vues sur d’autres scènes, en d’autres sortes de lieux ». Une nouvelle fois, le « spectateur agit », car « il observe […] il compare, il interprète. »4
Nous sommes désormais conditionnés pour alerter la sécurité au moindre soupçon. Le titre If you see something, say something le souligne. Partout dans le métro de New York, cette phrase est visible. Mais cela est devenu tellement normal que plus grand monde n’y prête vraiment attention – bien que le sens de la phrase soit définitivement absurde. Car l’on voit continuellement quelque chose dans le métro, et on devrait donc avoir toujours quelque chose à dire. Mais cela ne se passe évidemment jamais ainsi. Cependant, transposée dans le monde de l’art, cette phrase s’avère être intéressante. En effet, elle remet en question l’action de voir et le rapport entre la vue et la parole, l’image et le mot. Si l’on se représente littéralement cette phrase, elle signifie que le public devrait dire quelque chose lorsqu’il observe une œuvre – ce qui n’est pas le cas mais pourrait devenir une situation captivante. Pour Jérôme Leuba, cette double signification est caractéristique. En parallèle d’une réflexion politique liée à l’état du monde contemporain, son œuvre interroge également le fonctionnement et les mécanismes de l’art.
battlefield #37/focus (2008) est ce que Jérôme Leuba appelle une « sculpture vivante » (living sculpture). Depuis 2008, il a mis en scène un nombre croissant de ces œuvres performatives dont la forme – certes différente de celle de ses photographies – met néanmoins en œuvre des mécanismes et stratégies similaires. Réalisé à l’occasion de la participation de la galerie de l’artiste à la foire d’art contemporain de Cologne, battlefield #37/focus consiste en la réunion de vingt personnes sur un stand, comme s’il y avait quelque chose de spectaculaire ou d’exceptionnel à voir. Dos au public, elles empêchent de voir l’intérieur du stand. Tout au long de la journée, des visiteurs, attirés par cet attroupement, souhaitent se mêler au groupe et tentent d’apercevoir cet événement inhabituel. Peu d’entre eux se rendent alors compte qu’ils deviennent une part inhérente de la « sculpture vivante », qu’ils contribuent temporairement à son importance et à la faire vivre. Il n’y a plus de frontière entre le « voir » et l’« agir ». L’immense vide dissimulé derrière toute cette agitation se révèle symptomatique de la situation du marché de l’art actuel. En effet, l’on éprouve bien souvent ce sentiment que l’hystérie ambiante dans le fonctionnement du monde de l’art contemporain et les prix parfois aberrants de certaines œuvres ne reposent que sur ce genre de promesse vide.
Si battlefield #37/focus peut être compris comme un commentaire sur le fonctionnement du marché de l’art, le « vide » – qu’il met en scène – constitue lui aussi un thème fondamental dans l’œuvre de Jérôme Leuba, comme le révèle, par exemple, son diptyque battlefield #36/pictureless (2007). L’une des deux photographies montre un groupe de journalistes dans une clairière. Ils forment un cercle au centre duquel pourrait se trouver une personne importante, ou une découverte spectaculaire faite sur le lieu d’un crime, qu’ils voudraient photographier. Mais ni l’une ni l’autre des hypothèses n’est la réalité. Jérôme Leuba a rassemblé ces journalistes, leurs micros et caméras, autour d’un grand rien. L’impression d’ordre donnée par les médias verse ainsi dans l’absurde et ouvre un espace à de nouvelles lectures.
Au-delà de ces deux œuvres, le rapport entre le visible et l’invisible est un fil conducteur de l’œuvre de l’artiste5
. C’est ce que montre exemplairement battlefield #82/100 meters of curtain (2011). Réalisée au Centre d’art de Neuchâtel, cette œuvre se compose de cent mètres de rideau suspendus au plafond que Jérôme Leuba laisse filer, tels des méandres parcourant les salles d’exposition. Face à cette mise en scène théâtrale, le public, immanquablement, s’attend à ce que le rideau finisse par se lever et dévoile l’œuvre d’art. Pourtant, rien de tel ne survient. Cette draperie qui, une fois de plus, ne cache rien d’autre que le vide de la salle mais forme une frontière matérielle entre le visible et l’invisible, est la véritable œuvre d’art ainsi que le point de départ des images et pensées provoquées chez les spectateurs dès leur entrée dans le centre d’art.
L’une des premières œuvres de Jérôme Leuba, battlefield #4/verdun (2004), démontre que de telles images, surgissant dans l’imagination des spectateurs, dépassent en intensité la réalité. Présentés sur une table lumineuse, les six tableaux de l’œuvre sont des photographies de paysages de collines d’un vert intense. Des drapeaux, identiques à ceux d’un terrain de golf, sont plantés au sol. Cependant, ce qui ressemble, à première vue, à un paysage anodin d’été revêt une dimension bien différente à la lecture du sous-titre de l’œuvre. Les vertes collines se transforment soudain en tombes et ces violentes images de guerre, que nous avons tous vues dans des films et des livres, s’invitent dans le vide scénarisé par l’artiste. Ses photographies de Verdun rappellent certains clichés de rues abandonnées de Paris d’Eugène Atget, ces clichés qui amenèrent Walter Benjamin à les comparer à des photographies de lieux de crime : « Le lieu du crime est lui aussi désert. Le cliché qu’on en prend a pour but de relever des indices. Chez Atget, les photographies commencent à devenir des pièces à conviction pour le procès de l’histoire. C’est en cela que réside leur secrète signification politique. »6 Il en est de même pour battlefield #4/verdun qui, comme l’ensemble des œuvres de Jérôme Leuba, recèle une dimension politique cachée.