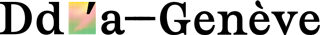Je n’arrive pas à me défaire de cette histoire que m’a racontée Anaïs Wenger. Lorsqu’elle était étudiante en école d’art, elle a souhaité faire une année de césure entre les premier et second cycle. Quand on prononce devant moi le mot de césure, je revois le directeur d’une école où j’ai enseigné, me disant, l’air grave (et la voix tout autant) : « Camille, il faut vivre des expériences »1 . Anaïs Wenger a sans doute voulu vivre une expérience, bien loin de la HEAD à Genève où les salles sont, paraît-il, bien chauffées et les sanitaires pourvus de savon. Entre deux jobs alimentaires et un stage dans un musée, elle a voyagé en Asie du Sud-Est ; pour la première version de ce texte, j’ai inventé une Anaïs Wenger baroudeuse, sac au dos et ampoules au pied, affrontant les kilomètres dans un circuit touristique façon Les Bronzés (à Pattaya). Mais l’artiste – douchant mon enthousiasme soudain pour un personnage de fiction que j’avais eu plaisir à inventer – a souhaité reprendre la main sur le récit, et m’a proposé de m’éloigner du fantasme pour revenir sur une des parties les plus singulières du périple. Elle a entendu parler des rizières en terrasse chinoises de Yuanyang au Yunnan, de l’autre côté de la frontière vietnamienne, et souhaite faire le détour. Ce sont elles qui ont fait la gloire du magazine Geo, réunissant tout ce qu’il faut pour un petit reportage idéal sur papier glacé : authenticité supposée, éloignement géographique du potentiel lectorat, colorimétrie impeccable et une bonne dose de photogénie2 . Lorsqu’Anaïs Wenger arrive sur place, la brume enveloppe tout : écrit ainsi, cela a l’air furieusement féérique mais non, la brume enveloppe véritablement tout. On ne voit strictement rien. Le lendemain, elle repart, toujours dans le brouillard, et une mauvaise langue comme moi dirait que ce n’est pas comme si elle avait parcouru huit mille kilomètres pour se retrouver nappée dans la même purée de pois qui recouvre parfois le canton de Genève. Tant pis pour les belles images, pour le pittoresque, et retour en Suisse, sans le souvenir des rizières en escalier. Ou peut-être bien que si, mais sans image. Car ce n’étaient sans doute pas tout à fait les images qui la préoccupaient, justement, mais la fameuse expérience, ciel voilé ou pas.
Anaïs Wenger s’étonne que cette histoire m’intéresse, elle prétend qu’elle me l’a rapportée comme ça, l’air de rien. Mais plus tard, quand je lui reparle des rizières invisibles du Yunnan, elle l’admet : à l’époque, elle s’était un peu préparée à ce qu’elle nomme de possibles déceptions épiphaniques. Non seulement je la crois sur parole, mais il me semble aussi que ce quasi-oxymore pourrait résumer avec une certaine élégance quelque chose qui traverse son travail : la recherche d’une merveille qui pourrait passer par la frustration, l’absurdité et quelques contrariétés à surmonter (ou pas). D’une certaine manière, Anaïs Wenger n’a pas peur des défis : quand elle est encore étudiante, elle fait l’acquisition d’une peinture un peu croûtesque, figurant le Salève (Mon Salève, 2016). Après avoir sanglé la toile et se l’être harnachée dans le dos, elle tâche, face au mont, de trouver le point de vue exact du – ou de la – peintre. Je l’imagine demander à sa complice, qui la photographie : plus à gauche ou à droite ? La Voyageuse contemplant une mer de nuages vaporeux sur le Salève est née. Elle se défend de tout regard moqueur : « Mon ironie est sincère » (décidément, Anaïs Wenger n’a pas peur des oxymores). Se placer dans la position de l’artiste du dimanche, et plus largement de l’amatrice est une récurrence dans son travail, le tout sans cynisme mais plutôt une curiosité face à l’absence d’expertise ou de virtuosité.
En 2019, elle est invitée en résidence au CAC de Genève ; l’atelier permet aux visiteur·ses de pouvoir contempler « l’artiste au travail » – tout au plus faut-il faire l’effort de grimper au dernier étage. Je ne sais si cela préoccupe Anaïs Wenger, mais dans le fond, je peux imaginer l’inquiétude, surtout si l’on préfère, à l’atelier – comme Christian Boltanski – regarder les pires idioties à la télévision ou – comme Gérard Garouste – jouer à la balle avec son chien3 . Elle se dit que tant qu’à être une otarie de cirque à faire sa belle, autant se lancer à fond. Les visiteur·ses qui passent voient un petit mot accroché à la porte de l’atelier, vide : « L’artiste est à la patinoire. » Si la concierge peut être dans les escaliers, l’artiste elle aussi peut être ailleurs, en l’occurrence à quelques minutes à pied du CAC. À la patinoire, Anaïs Wenger suit des cours pour devenir, le temps de la résidence, une athlète sur glace hors pair. Quitte à se former devant le regard d’autrui, elle préfère les gradins de la patinoire des Vernets voire même les baies vitrées qui donnent sur la rue, et les encouragements de son entraîneuse Corinne Djoungong, ancienne patineuse élite de Suisse. Un court film réalisé avec Sayaka Mizuno documente cette résidence transformée en entraînement intensif au patinage (Étoile, 2019) : on y devine bien vite que derrière le visage dépité d’Anaïs Wenger, qui vient encore de s’étaler de tout son long sur la glace, la comparaison entre sa situation de jeune artiste et celle de patineuse débutante n’est pas très loin. Corinne Djoungong lui parle de la chenille et du papillon, lui explique qu’elle grandit : « Il faudrait que tu trouves quelque chose qui t’habite. » Anaïs Wenger doit encore reprendre, recommencer, accepter les chutes, les imprécisions, l’imperfection : « Bienvenue dans la réalité du compétiteur » lui assène l’entraîneuse. La jeune artiste n’a pas l’air tant à l’aise dans son justaucorps blanc à sequins, les cheveux rattachés en chignon. Mais elle sourit, annonce qu’il lui faudra « aller au bout des gestes », espère qu’elle ne va pas à nouveau se vautrer. Et nous, quelle est notre place en tant que spectateur·trices de cet apprentissage ? Peut-on considérer que voir l’artiste souffler, suer, échouer, l’air contrit, est un spectacle intéressant ou plaisant ? Le ratage d’une pirouette Biellmann fait-il d’Anaïs Wenger une artiste moins aguerrie ? Quand je l’interroge, cela ne l’inquiète pas : pour elle, être artiste, c’est aussi cela. Ne pas être dans la maîtrise absolue, mais expérimenter continuellement, tenter, accepter l’insuccès, être dans une position d’apprenante, même si c’est un peu vacillant. Être, dit-elle, « bonne à tout et forte en rien ».
Parallèlement à ses études d’art, justement, elle a acquis une expertise singulière, en apparence éloignée des compétences transmises à la HEAD : au fil des années, elle a travaillé dans un bar à whisky, voyagé en Irlande puis en Écosse sur l’île d’Islay, réputée pour ses distilleries. Pour son diplôme de sortie d’école, elle construit un petit bar et propose aux membres de son jury de goûter des whiskies (Uisge, 2018). Elle fait naître par la parole un récit prenant sa source en Écosse, et emmène ses spectateur·trices – plus ou moins imbibés d’alcool – dans la tourbe avec elle.
Avec sa dégustation, Anaïs Wenger se place dans la lignée d’une Andrea Fraser organisant des visites dans d’importants musées, avec peut-être l’autorité en moins ; si le parallélisme avec le marché de l’art, ses futilités spécifiques, ses commentaires et ses gloses est inévitable, Uisge déplace la métaphore en dehors de l’institution. C’est d’ailleurs en s’éloignant le plus de supports visuels que l’artiste poursuit ses réflexions sur l’économie de l’art : en 2021, elle réalise Modern Muse, une vitrine comportant un certain nombre de flacons de parfums achetés dans le commerce, dont les noms reforment de nouvelles injonctions : « Enchanted / Flash », « Yes I Am / The Muse », « Yes Call Me / Modern Muse ». La froideur épurée des bouteilles, leur supposée élégance, leur apparent bon goût, se retrouvent quelque peu giflés par la mise en scène d’Anaïs Wenger. Les évocations imagées caractéristiques du secteur du luxe – féminité exacerbée, érotisme mondain… – rétrogradent immédiatement du côté du pur langage. Les parfums restent dans leur vitrine, objets de désir inaccessibles dont les effluves ne viennent pas imprégner l’espace d’exposition.
Toutefois, on aurait tort de voir en Anaïs Wenger une parangon radicale d’un minimalisme helvète cérébral4 : ses références vont plutôt chercher du côté de la maladresse de Valérie Donzelli ou de Phoebe Waller-Bridge, des héros pathétiques et touchants des films des frères Cohen, des chansons qui lui font verser une petite larmiche, des mélos en tout genre, de la poésie du carton-pâte. Le conceptuel, elle l’embrasse, bien sûr, mais uniquement s’il peut s’avérer un peu kitsch, un peu cheap, un peu sentimental, un peu larmoyant. On ne s’étonnera donc pas de la voir apprécier des formes assez liquides, qui volontairement s’échappent : les parfums, bien sûr, mais aussi la résine dans laquelle elle coule des catalogues d’exposition de Monet (Impressions, 2024). Les nymphéas si évanescents du peintre impressionniste sont figés à vie dans ce qui paraît d’abord comme de la gelée, avant de révéler leur consistance. Lorsqu’on tente de commenter l’installation, d’autres voix apparaissent, nous intimant de nous taire par des Chut ! fort autoritaires, réminiscence des rappels à l’ordre des gardien·nes de l’Orangerie à Paris. Récemment, elle élaborait aussi une performance pour la Fondation Bally (Lugano), incitant le public à la suivre dans un périple conté autour des imaginaires lacustres. Au terme de You must have consider bathing (2024), Anaïs Wenger, chaussée depuis le début de la performance de cuissardes de pêcheur, s’élance face à une boiserie et effectue un parfait appui tendu renversé. De ses cuissardes s’échappent alors des centaines de petits morceaux de miroirs, qui viennent recouvrir le sol (et accessoirement effrayer une visiteuse qui avait eu le malheur de s’asseoir à côté de la boiserie). Je me fais la réflexion, en voyant des images de l’événement, que l’artiste aime les changements d’état, et préfère nettement à la glace de la patinoire l’eau du lac, toutefois ici encore métamorphosée. Mais il n’y a pas que cela : certes, les fragments de miroir tombent et tapissent le revêtement blanc de la salle, et le tout ne manque pas de grâce. Cependant il faut voir Anaïs Wenger, mains au sol, pieds en l’air, tortiller des chevilles pour faire chuter les dernières tesselles pour comprendre, si ce n’était pas déjà fait, que ce qui la fascine dans les liquidités, c’est justement la fluidité. Somme toute, c’est ne pas avoir à choisir, être à la fois dans le one-woman show et l’intensité de Maria Callas, accepter les larmes du rire et celles de la tragédienne. Quand en 2022, assistante à la HEAD, elle invite différent·es employé·es de son école – huissier, assistantes, adjointes scientifiques, enseignant·es, secrétaire… – à former un chœur venant entonner une pièce sonore portant notamment sur l’enseignement et la transmission de l’art (Dear colleague), elle se situe encore une fois volontairement sur la ligne de crête.
Depuis peu, Anaïs Wenger, qui préfère se définir comme promeneuse que comme chercheuse – lorsque je lui pose la question – s’intéresse à ce qui se trame dans les airs. Il n’y a pas que dans l’eau que l’on flotte, et la voilà qui songe à des cerfs-volants (Pays bleu, 2024) sur lesquels ont été imprégnés par le procédé du cyanotype des reproductions de nuages. Ceux-ci, loin d’être de banals cumulo-nimbus de notre temps présent, sont issus d’une fresque datant d’avant le tragique tremblement de terre de 1755 qui ravagea Lisbonne. Dans le ciel désormais très bleu de la capitale portugaise où elle passe une partie de son temps, Anaïs Wenger fait flotter ses cerfs-volants, et nous laisse osciller entre les interprétations, la beauté légère des nuages sur fond azur ou la menace qui gronde avant l’orage. Encore une fois, refuser de choisir.