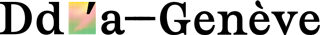1
Des formations dans le ciel : c’est ainsi qu’un de mes amis décrit les nuages.Sans eux, l’aube ne nous arriverait pas sous forme de lumière. Un jour, la lumière nous parvient comme une nébuleuse. Le lendemain, elle se drape dans les arches des nuages. Un jour de ciel bleu clair, la lumière nous paraît sûre et bonne comme une compagne de vie.
Ce moment qui porte le nom de matin – qui sait où il commence et où il finit. La lumière du matin, combien elle change vite, du jaune pâle au rose, puis à un orange incandescent, puis tout le reste… C’est comme ça, l’été, là où je vis. C’est de là, de là où j’écris, que je suis entré en contact avec Alan Bogana. Pour lui c’était le matin, pour moi le début de la soirée. Tandis que nous étions enfermés tous deux dans ce mode d’existence sur écran, la lumière à l’extérieur aura changé un million de fois. Au cours d’un de ces entretiens, Alan m’a parlé du trouble de la vision dont souffrait Claude Monet. Monet vivait dans une autre lumière que nous.
La lumière est source d’inspiration pour Alan – pas les rayons nets et directs, mais la lumière qui produit les nuances et les ombres. Il travaille sur différents aspects de la lumière – naturelle ou artificielle – sur la manière dont les corps humains y réagissent, ses reflets, la réfraction. Il s’intéresse à la représentation de la lumière.
Au cours de nos entretiens, nous avons évoqué les Mémoires d’aveugle de Jacques Derrida et l’Éloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki. Les abeilles et des lucioles, aussi. J’ai dit à Alan ma fascination devant les paysages fantomatiques de certaines de ses oeuvres anciennes comme CASE 03D – P1 – Diamond Mountain Drift (2013). Les feux d’artifice à Genève le jour de la Fête nationale suisse, ceux qu’il y a parfois à Hong Kong, tout cela nous l’avons partagé. Avec le recul, il me semble que nous avons échangé sur les formes de sensibilité que son art inspire ; et je suis devenue plus consciente du rôle de certaines d’entre elles dans ma vie.
Par exemple, la pluie d’été dans ses relations avec la lumière.
Les fenêtres des bus municipaux de Hong Kong sont généreusement ouverts sur le paysage. La nuit, on distingue les lumières à n’importe quelle distance – celles par exemple des immeubles d’habitation publics de 40 étages. Les immeubles sont des grilles dans un spectre de jaune et de blanc – lampes fluorescentes, LEDs… certainement pas des bougies allumées, bien que de petits bulbes en forme de bougies diffusent une lumière rouge et veillent sur les dieux dans les sanctuaires. Dans les rues, les lumières alignées au plafond des passerelles piétonnières surélevées éclairent la voie. Les feux de circulation, les sirènes des véhicules prioritaires, parfois un vélo agrémenté d’une dynamo… se réfléchissent sur l’asphalte trempé par la pluie. Les canaux eux-mêmes deviennent des toiles peintes de lumière.
Se trouver à l’étage supérieur d’un bus à impériale sous une pluie battante, voilà un vrai plaisir d’été. Lorsqu’il pleut très fort, les gouttes qui tombent sur les vitres sont violemment projetées vers l’arrière. Les enseignes qui s’étalent sur les façades immenses – principalement des publicités – deviennent de simples jets d’aquarelle à la manière de l’action painting et dissipent l’effet de ce régime visuel coercitif.
J’habite un endroit nommé Plover Cove, à l’extrémité nord-est de Hong Kong. C’est un quartier tout à fait urbain mais les lumières du genre que je viens d’évoquer y sont moins gênantes. Lorsque la nuit est calme, que l’air semble épuisé après des jours de pluie alternativement violente ou légère, je reconnais même les reflets des immeubles résidentiels et des bâtiments industriels à la surface de l’eau – des coups de brosse verticaux, du haut vers le bas, oranges et jaunes, et qui tremblent.
Lors de notre première conversation, Alan m’a lu un passage de Le Monde, la chair et le diable (1929) de John D. Bernal. Les lignes suivantes m’ont particulièrement intrigué :
« Au bout du compte, la conscience pourrait bien disparaître avec une humanité devenue entièrement immatérielle, ayant perdu son caractère organique étroitement soudé, transformée en masses d’atomes dans l’espace communiquant par radiations – pour finir peut-être par se dissoudre complètement dans la lumière. Cela pourrait être une fin ou un début ; mais, de là où nous nous trouvons, nous ne pouvons rien en savoir.»
Je relie cet extrait à ce que me montre le portfolio d’Alan. Sa pratique épouse l’atomique comme l’universel. Alan touche la force et le déclin de la lumière, et se laisse toucher par eux. Aucun drame dans la tension qu’il distingue. C’est avec hospitalité qu’il embrasse ce qui trahit l’appauvrissement des mots.
Alan a vu la lumière réduite en esclavage au service du spectacle. Il réplique en lui rendant son dû, en la restituant à sa multiplicité et à sa mutabilité. Il se refuse à faire de la lumière un objet. Il n’y parvient, à mon sens, que grâce à sa sensibilité au monde tel que la nature l’a fait.
« Peu importe la signification des étoiles du point de vue de l’astronomie : on ne les perçoit pas les étoiles comme des objets mais comme des points de lumière, et les crépuscules comme un bref embrasement du ciel lorsque le soleil disparaît derrière l’horizon. Les uns comme les autres évoquent surtout une tumescence vaporeuse et incohérente en expansion, qui se déplace au gré des courants du médium.» (Tim Ingold, Being Alive: Essays on Movement, Knowledge, and Description, 2011, p. 117.)
C’est cette puissance de perception qui fait de lui un artiste.