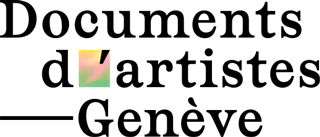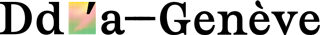« Square (2019, vidéo, couleur, muet, 2 min) repose sur un autre processus de construction : le plan est fixe ; et il délimite strictement un espace (il n’y a pas de possibilité de hors-champ pour les passants filmés : lorsque que l’on quitte le cadre, on quitte la représentation, sans possibilité de retour). Dès lors, tout mouvement ne peut se déployer qu’à l’intérieur du champ, institué d’emblée et définitivement (peut-être arbitrairement ; en tout cas il contient et restreint la représentation). Square signifie une forme – le carré – et un espace public aménagé en tant que loisir – le square public. Conformément à l’énoncé de son titre, l’installation consiste en un plan fixe, filmé en forte plongée, et parcouru par des passants. Le sol, à travers l’angle de prise de vue, devient le lieu de la représentation, le motif de la bande. Conformément à la logique de la mise en abîme, il est possible de distinguer différents carrés au sein du sol qui est cadré par la caméra, et qui sert de support aux va-et-vient de personnes indifférenciées. Ce qui me paraît ici remarquable, c’est la conception de l’espace mise en jeu : ce n’est pas une grille qui se dessine, mais un damier dans un carré, à l’instar de Malevitch. Des personnes apparaissent, disparaissent, seules ou en groupe. Elles se meuvent selon leur propre volonté. Le principal procédé « intrusif » du film est le fondu enchaîné qui transforme l’espace de la représentation : comme dans les vues à truc de Méliès, les figures sont escamotées mais le cadre demeure fixe. En ce sens, Square tire profit, voire thématise, la construction même de l’image vidéographique : le montage a lieu à l’intérieur même du plan, et non dans le passage d’une vue à une autre ; la coupe étant interne au plan, le montage est reporté sur une dimension temporelle et non spatiale. Les embryons d’interaction – physique, sociale – qui pourraient apparaître entre les passants sont immédiatement interrompus par le procédé du fondu. En ce sens, par la technique de la vidéo, Square signifie encore une fois une dynamique qui est de l’ordre de la négation de l’interaction, les réseaux de communication remplaçant l’échange intersubjectif. »
Extrait du texte de François Bovier, *Véronique Goël, Films et installations, 1979 - 2023*, 2024