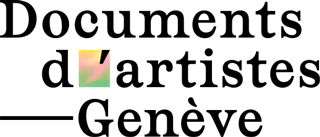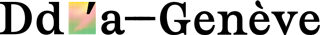Cahier de la classe des Beaux-Arts 133
Novembre.
9 novembre 1989.
Ecroulement du mur de Berlin.
Soulagement.
Fin du totalitarisme dans cette partie-là du monde.
Plus de police politique, un peu de liberté retrouvée.
Changement radical pour marquer la fin d’une décennie médiocre.
Novembre.
9 novembre 1999.
Nos gouvernements célèbrent à grand renfort médiatique et longs discours
lénifiants, tous unanimes, tous identiques, le dixième anniversaire de l’enterrement du communisme et le triomphe, donné comme définitif, du capitalisme.
Plus de peurs à avoir.
Sous le cynisme ludique de l’époque, que reste-t-il?
Bitterfeld. Wolfen.
Ces deux noms n’évoquent sans doute rien pour la plupart d’entre nous. Par contre, si l’on mentionne Dessau, l’attention s’éveille. Et pour que cela commence à faire vraiment sens, il faut y adjoindre Zschornewitz (qui sera pour quelques décennies la plus grosse usine de production d’électricité d’Europe) ou encore Agfa (implantée à Wolfen dès 1894), ainsi que le nom de Rathenau, une famille d’industriels berlinois aux idées sociales très avancées.
Emil Rathenau (1838-1915) découvre l’invention d’Edison à la foire de Paris de 1881. Enthousiasmé, il achète la licence. A Berlin, il fonde en 1883 sa première société pour la distribution et la production des lampes à incandescence en Allemagne. En 1887, elle prend le nom d’AEG. Cofondateur du Werkbund, il engage en 1907 Peter Behrens (1868-1940) comme architecte et conseiller artistique pour le design de la production.
Walther Rathenau, son fils (1867-1922), implante en 1893 la première usine d’électrochimie de Bitterfeld. Auteur d’un ouvrage sur les possibilités d’amélioration des conditions de travail et de vie des ouvriers dans l’industrie moderne, il sera assassiné en juin 1922 par une brigade des “Freikorps” alors qu’il était ministre des affaires étrangères de la République de Weimar.
Bitterfeld, Wolfen, Greppin, Dessau, Zschornewitz…
En raison de ses immenses réserves de lignite exploitées depuis 1840 et de sa situation au croisement des lignes ferroviaires construites entre1870 et 1880 pour relier Leipzig et Halle à Berlin, cette région deviendra, passé le temps des pionniers, le cœur de l’industrie chimique de l’Allemagne, puis celui de la RDA. Située à une centaine de kilomètres au sud ouest de Berlin, sillonnée par la Mulde dont le lit est assez libre et sinueux et délimitée au nord par l’Elbe, cette région, avec ses forêts de bouleaux, ses étendues sablonneuses à la végétation un peu sauvage, ses lacs et ses lumières atlantiques, forme une plaine immense et plate aux paysages magnifiques.
Novembre 89.
L’Occident — dont le palmarès des catastrophes industrielles n’a rien à envier à personne— “découvre” avec “horreur” l’état de “délabrement” de l’industrie et des usines chimiques de la RDA et la “catastrophe écologique” que tout cela représente. Les médias se chargent de noircir le tableau avec une systématique bien à eux. Les images sont sinistres.
En réalité, l’Allemagne unifiée n’a que faire de l’accroissement de son parc industriel.
La liquidation est planifiée à court terme. La radicalité et la brutalité des mesures parlent d’elles-mêmes. Pas moins de 30’000 travailleurs sont concernés. La CKB (Chemie Kombinat Bitterfeld) employait à elle seule 17’000 personnes. S’ajoutent les travailleurs des secteurs de l’extraction du charbon, de la production de briquettes,
de briques et de terre cuite, des usines d’électricité ou encore d’Orwo, le “Kodak” de l’Est.
Compensation: les travailleurs sont engagés pour démanteler leurs usines et nettoyer le territoire. Pièce par pièce, morceau par morceau, tout est trié, démonté, recyclé avant que les bâtiments eux-mêmes ne soient démolis.
Aujourd’hui, il ne reste plus rien ou presque….
On conservé quelques bâtiments, constitué un musée du cinéma à Wolfen, un autre de l’industrie à Zschornewitz. Mais la “Rathenau Haus” — symbole de toute une époque — a été démolie.
Bayer a eu la grandeur d’âme d’implanter sur les lieux un nouveau site de production d’aspirine, ultra moderne et entièrement automatisé. C’est clean et écologiquement parfait, mais, étonnamment, cela pue toujours.
La chimie n’a pas encore réussi à perdre toutes ses odeurs…
Texte de Véronique Goël