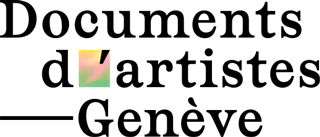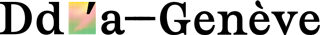Un ensemble de trois courts ou moyens métrages constituent un autre cycle dans l’œuvre de Véronique Goël, recoupé à travers le titre générique de Soliloque. Celui-ci s’ouvre sur une vidéo, Soliloques pour voix de femme et frigidaire (1978, n/b, ½’’, 17 min) qui exploite les possibilités de la vidéo de façon minimale, suivant une démarche littéraliste : il s’agit d’un long plan continu, ponctué à la fi n par un fondu au noir. Cadrés en plan large, un homme (Yves Tenret, qui cosigne le texte) et une femme (Frédérique Aeschbacher) sont assis chacun sur une chaise, dos à dos, comme pour signifi er une impossibilité de communiquer ou en tout cas une diffi culté à échanger. L’image d’un couple est suggérée et dans le même temps niée, celui-ci étant présenté comme désuni, voire opposé. En voix-over, se déploient deux monologues intérieurs, tour à tour, qui ne forment pas un dialogue. Bien au contraire, les voix-over – incarnées par Pierre-Alain Schatzmann et Véronique Goël, accentuant en-
core l’effet de dissociation entre la voix et le sujet filmé – charrient
une parole qui est de l’ordre du ressassement, de l’épuisement, plus proche du théâtre beckettien que du monologue de Molly Bloom dans Ulysse. Les personnages sont désindividualisés : on comprend que l’homme est un écrivain, dont la posture existentielle s’apparente à la négation, au désaveu, au cynisme ; par contre, il est difficile d’assigner une identité à la femme, qui se caractérise par une attitude de refus, de rejet, de renonciation. Pourtant, le titre de la
vidéo indique bien que c’est la femme qui est au centre de l’énonciation. Le parti pris de cette bande vidéo se caractérise par l’insistance de sa durée non fragmentée. Cependant, l’immobilité apparente du « couple », assis dos contre dos et non pas côte à côte, composant un « tableau vivant » fi gé, déthéâtralisé, est contredite par le déplacement des mains de Yves Tenret, puis par le mouvement conjoint de la tête des deux personnages, tournant leur
visage en direction du spectateur. Ce mouvement d’adresse au public, toutefois, est suspendu ou inabouti, à peine esquissé. Dans cette bande vidéo, le langage prime avant tout : les soliloques ou monologues des deux « modèles » sont écrits suivant un mode énonciatif paradoxal, à la fois blanc, neutre, atone, et intime, subjectif, personnel. Un théâtre de la désaffectation, de l’incommunication, c’est ce qu’évoque cette première œuvre.
Extrait du texte de François Bovier, *Véronique Goël, Films et installations, 1979 - 2023*, 2024
CRÉDITS:
Textes: Yves Tenret, Véronique Goël
Voix off: Pierre-Alain Schatzmann, Véronique Goël
Avec Yves Tenret, Frédérique Aeschbacher