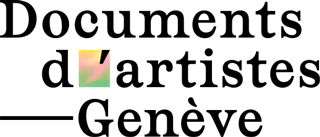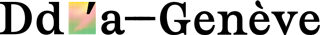« Soliloque 3 (1992, 16mm, 37 min), centré sur la ville d’Oran en Algérie, est sans doute le film le plus explicitement politique de la série, tout particulièrement en relayant des prises de positions féministes, par le biais de photographies de femmes pendant la guerre d’Algérie et par la suite. Comme les autres films de la série, le son est utilisé en contre-point des prises de vues : des extraits de deux romans de Kateb Yacine, Le polygone étoilé et La femme sauvage1 , sont lus en voix-over (par Claudine Després). La ville est d’abord présentée à travers une série de plans fixes sur des immeubles du centre-ville (caméra à l’épaule ou sur trépied). L’espace urbain est ensuite traversé, le plus souvent à travers des travellings latéraux en voiture. Aux immeubles coloniaux des années 1930 succèdent les rues commerçantes. Dans les deux cas, une image de l’altérité se construit, à travers une certaine distance. La double graphie des enseignes et des devantures – en arabe et en français – contribuent à inscrire le film vis-à-vis de l’histoire du colonialisme. La bande-son est principalement constituée de sons directs, recouverts par la voix-over qui intervient ponctuellement mais de plus en plus souvent et longuement. Aux mouvements de la caméra répond la litanie de la voix : une fois encore, un soliloque, porté par une voix de femme. L’apparition soudaine de photographies, recadrées au banc-titre, interrompt le cours du film, à travers un effet de suspens. Elles contaminent les plans en mouvement ; les travellings en voiture ou les plans fixes tournés à l’épaule se trouvent ainsi réancrés et interprétés à travers un prisme de lecture politique.
L’alternance ou le contraste entre le noir-blanc des photographies et les plans tournés en couleur structurent le rythme du film. Les photographies sont centrées sur des femmes et leur implication pendant les manifestations, les luttes et la guerre qui ont finalement mené à l’indépendance. L’une d’entre elles est analysée, et émotionnellement parcourue. La séquence est longue et dépourvue de son ; elle constitue à la fois le point d’acmé et le point d’arrêt du film. Le recadrage au banc titre permet de fragmenter les protagonistes, d’explorer les corps mais aussi l’arrière-plan : cet effet de réarticulation et de remontage d’une image fixe imprime un mouvement à la photographie.
La fragmentation et la relecture de la photographie impulsent un dernier tournant au film. L’enjeu n’est plus d’intercaler des photographies qui interrompent le flux des plans. Le découpage opéré par la caméra sur les photographies au banc-titre est reproduit au sein de séquences filmées par l’équipe de tournage, le passé orientant résolument la lecture du présent. Deux séquences sont filmées dans des cafés, dont les seuls clients sont des hommes : ce que montre le film, c’est un espace de socialisation exclusivement masculin, un espace public qui repose sur une série d’exclusions. Les prises de vues, animées, décalquent le mouvement de relecture des photographies : un lieu asphyxiant s’oppose à l’espérance promise par la guerre d’indépendance et la libération, ainsi qu’à la place active que les femmes y ont joué. S’ensuit une série de plans de nuit, les rues étant quasi désertes ; l’espace public est désormais laissé vacant. Résonne, après un certain temps, un chant traditionnel de femmes (recueilli et interprété par Taos Amrouche), évoquant la douleur des femmes, la perte de l’homme aimé et, on peut le supposer, une déperdition plus généralisée. Par un travelling-arrière, on quitte ce milieu et on laisse entrevoir la possibilité d’un autre monde. En effet, le film se clôt sur une photographie ou une note positive : une athlète algérienne, Hassiba Boulmerka, offre à l’Algérie sa première médaille d’or, lors de sa victoire aux Jeux Olympiques de Barcelone (quand bien même Boulmerka sera-t-elle contrainte à quitter l’Algérie). Le film suggère ainsi qu’une autre place est possible pour les femmes en Algérie, la course et les enjeux afférents n’étant pas simplement olympiques. »
Extrait du texte de François Bovier, Véronique Goël, Films et installations, 1979 - 2023, 2024
CRÉDITS:
Images: Alain Grandchamp
Son: Ahmed Arb
Montage: Véronique Goël
Direction de production et régie: Rachid Nafir, Hachemi Zertal
Mixage: Florian Eidenbenz
Banc-titre: Richard Vetterli, Véronique Goël
Trucage: Hermann Wetter
Etalonnage: Philippe Benoit
Musique: monodie berbère de Kabylie par Marguerite Taos Amrouche